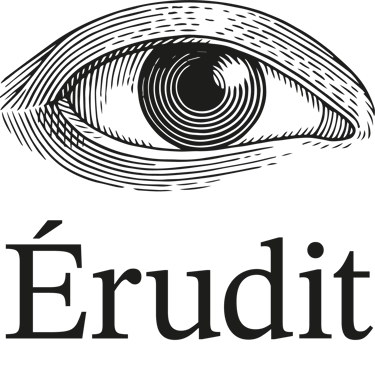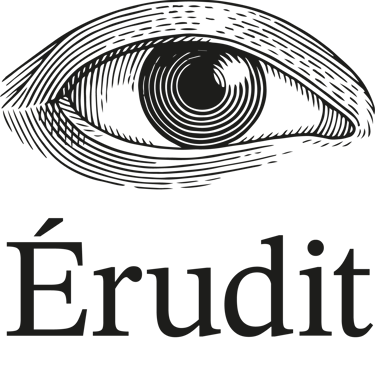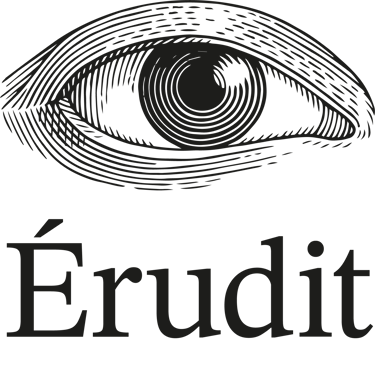Particularité iconographique chez Frans Floris : quels attributs pour les vierges sages ?
HISTOIRE DE L'ART
Vincent Lambert
1/16/202515 min temps de lecture
La parabole des vierges sages et des vierges folles (Mt. 25, 1-13) s’inscrit dans le discours eschatologique de saint Matthieu. Anticipant le Jugement dernier, les treize vers font référence à dix vierges s’apprêtant à rejoindre l’Époux, incarnation narrative du Christ. Si toutes sont munies d’une lampe à huile, seulement cinq d’entre elles ont fait preuve de vigilance en prévoyant de l’huile supplémentaire. En cela, ces cinq vierges, alors qualifiées de sages, se sont assurées de pouvoir faire briller leur lampe jusqu’à l’arrivée de l’Époux. Les autres, les insensées, dont l’huile vient à manquer et dont les lampes se trouvent éteintes au moment propice, se trouvent rejetées par le Christ : « Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas. » (Mt. 25, 12). Ainsi, saint Matthieu préfigure dans son discours parabolique, le moment où les élus accéderont à la demeure du Christ, tandis que les damnés en seront rejetés.
Longtemps annexée au thème du Jugement dernier dans la statuaire religieuse française et germanique, la parabole des dix vierges connaît un véritable essor dans les arts visuels flamands au cours de la seconde moitié du XVIe siècle. Parmi les acteurs de ce phénomène d’autonomisation du sujet, il convient de se pencher sur celui que Karel van Mander surnommait le « Raphaël flamand » : Frans Floris.[1]
Artiste-peintre et dessinateur, dont l’atelier était l’un des plus prolifiques de la ville d’Anvers au milieu du XVIe siècle, Frans Floris réalise sa version peinte de la parabole vers 1559 (fig.1). L’œuvre, une huile sur toile de 118 par 132 centimètres, aujourd’hui conservée au sein d’une collection privée, présente une composition bipartite, traditionnellement adoptée dans les représentations de la parabole. [2] Selon une opposition des deux groupes de vierges, les sages sont représentées à gauche, tandis que les folles, en partie plongées dans un profond sommeil, sont représentées à droite. Le caractère sage ou fou des vierges, est essentiellement signifié par leur attribut conventionnel : la lampe à huile, allumée ou éteinte. Par ailleurs, Floris témoigne d’une lecture méticuleuse du texte matthéen, en ce qu’il met l’accent sur le détail faisant des cinq vierges de gauche, des vierges sages. Ces dernières se trouvent occupées à réapprovisionner leur lampe à l’aide de récipients d’huile, soulignant ainsi leur prévoyance, soit la qualité qui les distingue des insensées.


Figure 1 — Frans Floris, Les vierges sages et les vierges folles, c. 1559, huile sur toile, 118 x 132 cm, collection privée (Vendu à Londres, Sotheby’s, 4 juillet 1990, lot 39). © Encyclopædia Britannica (Tous droits réservés).
Cependant, un ensemble de motifs vient s’adjoindre de manière inédite aux attributs traditionnels des cinq vierges sages. Notre regard doit alors se porter sur la vierge sage occupant l’avant-plan du coin inférieur gauche (fig. 2). Vêtue d’un drapé de couleur jaune, elle s’emploie à allumer sa lampe, tandis que l’une de ses comparses y verse de l’huile. Accroupie, proche du sol, son genou présente un contact plastique avec un globe terrestre sur lequel repose sa lampe, et dont on ne distingue qu’une forme demi-sphérique. À la base de ce globe, dans l’ombre portée qu’il projette sur le sol garni d’une touffe d’herbe, il est possible de distinguer un compas, dressé, planté dans la terre. Le globe et le compas sont finalement accompagnés de ce qui s’apparente à un livret musical et à une partition volante dont les notations semblent schématiques. En introduisant ces objets aux côtés des vierges sages, Frans Floris s’écarte quelque peu des conventions iconographiques de la parabole, jusqu’alors très limitées. En cela, il s’inscrit dans le phénomène d’autonomisation du sujet de la parabole, et de l’enrichissement de sa représentation visuelle. [3] Dès lors, considérant cette particularité, il convient de tenter d’en fournir les clés d’interprétation.


Figure 2 — Frans Floris, Les vierges sages et les vierges folles (détail), c. 1559, huile sur toile, 118 x 132 cm, collection privée (vendu à Londres, Sotheby’s, 4 juillet 1990, lot 39). © Encyclopædia Britannica (Tous droits réservés).
Les trois objets évoqués – le globe, le compas et les partitions musicales – ont pour dénominateur commun, leur appartenance, en tant qu’attributs, à la représentation visuelle des sept Arts libéraux. En effet, le globe terrestre et le compas désignent traditionnellement l’allégorie de la Géométrie, tandis que les partitions musicales accompagnent, inévitablement, l’allégorie de la Musique. Notons qu’il est nécessaire de se prémunir d’un rapprochement systématique de la représentation de ces objets avec une référence aux Arts libéraux, encore moins lorsque lesdits objets ne sont présents qu’en petit nombre. En revanche, dans le cas de l’œuvre de Frans Floris, plusieurs éléments tendent à penser que l’artiste propose ici une forme de condensation iconographique entre les vierges sages et le thème des sept Arts libéraux. [4] Si l’on s’intéresse à la date de réalisation de l’œuvre Les vierges sages et les vierges folles, à savoir la fin des années 1550, l’on constate une proximité temporelle certaine avec un important chantier artistique ayant occupé Floris. En effet, ce dernier achève en 1557, le second cycle de peintures monumentales commandées par le riche banquier, marchand et collectionneur anversois Niclaes Jonghelinck (1517-1570) pour sa nouvelle demeure. S’inscrivant dans la pratique du studiolo italien, ce cycle décoratif destiné à orner la bibliothèque du commanditaire a pour sujet : les Arts libéraux. Chacun des sept Arts se trouve alors personnifié et contextualisé dans une scène plus ou moins narrative. Il est aisé de retrouver les objets-attributs mentionnés ci-dessus, dans les représentations des Arts auxquels ils sont associés. Ainsi, dans la partie inférieure de la Musique (fig. 3), des feuillets musicaux jonchent le sol, tandis qu’un globe terrestre occupe l’espace central de la Géométrie (fig. 4) dont la personnification, munie d’un compas, s’applique à calculer des distances.




Figure 3 — Frans Floris, Musique, 1557, huile sur toile, 151.2 x 174 cm (à l’origine 122 x 174 cm), Genève, coll. privée. © Tous droits réservés.
Figure 4 — Frans Floris, Géométrie, 1557, huile sur toile, 150.5 x 173 cm (à l’origine 125 x 173 cm), Genève, coll. privée. © Tous droits réservés.
De récentes études ont démontré que la source textuelle utilisée par Floris et son atelier pour mettre au point le programme iconographique du cycle, est l’œuvre de l’auteur carthaginois Martianus Capella (ca. 360-428) : les Noces de Philologie et Mercure. [5] Le récit, composé en vers latins et en prose, narre, en neufs volumes, la cérémonie de mariage unissant la mortelle Philologie au dieu Mercure. Cette source figure parmi les premières à traiter des Arts libéraux dans leur ensemble, devenant ainsi une référence pour leur représentation dans les arts visuels. En effet, une fois la narration installée, et les noces racontées dans les deux premiers volumes, les sept suivants mettent en scène le cortège de sept demoiselles d’honneur offertes par Mercure à sa promise. Chacune de ces jeunes filles incarne une discipline (disciplinae) : grammaire, dialectique, rhétorique (sciences littéraires), puis géométrie, arithmétique, astronomie et harmonie (sciences mathématiques). Dans le récit de Capella, ces personnifications des sciences ont pour fonction d’aider Philologie à rejoindre Mercure, soit d’accompagner une mortelle dans son ascension vers les dieux.
C’est précisément cette même idée qui se trouve réinvestie au XIIe siècle par le théologien français Alain de Lille dans son œuvre l’Anticlaudianus. Écrite entre 1180 et 1185, cette épopée en neufs chants comprenant 4350 vers, offre une version moralisée des Noces de Martianus Capella. En savant théologien, Alain de Lille élabore le récit du projet de la Nature de créer un « homme nouveau », une créature parfaite qui rédimerait les imperfections de ses actes passés. Au cœur de la réalisation de ce projet, une place importante est donnée au personnage de Prudentia. En effet, avec l’assistance des sept Arts libéraux et de la Théologie, Prudentia monte jusqu’au ciel pour plaider la cause de la Nature et de son « nouvel homme » devant Dieu. La proximité narrative avec les Noces de Capella et sa postérité certaine, font de l’Anticlaudianus une seconde source textuelle certainement convoquée par Frans Floris au cours de ses recherches pour l’élaboration du cycle des Arts libéraux. [6]
Dès lors, si l’on considère Frans Floris comme lecteur de Martianus Capella et d’Alain de Lille, il est loisible de comprendre la présence du globe, du compas et des partitions musicales, auprès des vierges sages dans sa version peinte de la parabole, réalisée, pour rappel, peu de temps après le cycle des Arts libéraux. D’abord, l’on constate une proximité entre les arcs narratifs des Noces et de l’Anticlaudianus d’une part, et de la parabole des dix vierges d’autre part. En effet, dans chacun des cas, il est question d’une réunion entre une part humaine et une part divine. Par ailleurs, cette union se réalise au moyen d’une ascension. Également, les trois textes accordent une place notable à la sagesse. Dans la parabole, la sagesse est le trait de caractère désignant celles qui accèdent à l’Époux, au Christ. Dans les Noces de Philologie et Mercure, l’auteur souligne la vertu de Philologie qui s’applique à cultiver sa sagesse :
« Vraiment, elle [Vertu] n’allait pas oublier de rappeler que Philologie […] est la bienfaitrice de Sophia [la Sagesse] elle-même par ses généreuses récompenses [les disciplinae] pour compléter son trousseau ! ». [7]
De même, dans l’Anticlaudianus, la sagesse est au cœur du récit. En effet, Prudentia est la personnification même de la sagesse humaine, et c’est elle qui monte au ciel pour rencontrer Dieu. [8] Ainsi, considérant la proximité entre les représentations de ces deux thèmes dans la chronologie de la carrière de l’artiste, et leurs similitudes narratives, il n’est pas improbable que Floris ait transposé certaines idées relatives au cycle des Arts libéraux dans sa version peinte de la parabole des dix vierges. De plus, il nous faut souligner que, dans les Noces et dans l’Anticlaudianus, les Arts libéraux sont particulièrement liés à la sagesse. En effet, dans le récit de Capella, la sagesse est induite par le savoir de Philologie. Ce savoir correspond aux disciplinae soit aux sept Arts libéraux. [9] Par ailleurs, les Arts libéraux constituent un élément favorable à l’ascension de Philologie qui est « familiarisée avec les arts qui peuvent atteindre les sommets du ciel par la tension de l’intellect ». [10] Dans l’Anticlaudianus, plus qu’un élément favorable, les Arts libéraux sont ceux qui construisent le char permettant à Prudentia (Sagesse) de rejoindre les cieux et de rencontrer Dieu :
« Sans plus tarder, elle [Prudentia] ordonne de construire un char qui la conduira jusqu'au ciel. Sept jeunes filles d'aspect semblable, mais différentes de costume et d'attributs, assistent les Vertus et s'empressent d'exécuter les intentions de Prudence. Ce sont les sept Arts libéraux qui possèdent le secret de toutes les activités humaines. » [11]
Ainsi, le lecteur comprend que l’ascension céleste, soit la rencontre avec le divin, est conditionnée par la sagesse, qui elle-même est conditionnée par les sept Arts libéraux. En outre, il semble que ce soit précisément la capacité des Arts libéraux à accompagner l’élévation spirituelle d’un individu, qui ait été retenu par Frans Floris et condensé avec la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ainsi, les trois attributs traditionnellement présents dans l’iconographie des Arts libéraux, à savoir, le globe, le compas et les partitions musicales, sont réinvestis par l’artiste en tant que marqueurs du caractère sage des vierges représentées dans la partie gauche de la toile (fig. 1). Faisant cela, Frans Floris fait la démonstration de sa qualité d’inventor, en ce qu’il propose une lecture inédite et originale du personnage de la vierge sage, renouvelant ainsi le processus de son identification par le spectateur. En dernière analyse, il ressort avec évidence que ce procédé pictural trouve une forme de postérité dans les cercles artistiques anversois. Cet héritage s’illustre particulièrement dans l’œuvre de l’un des élèves de Frans Floris : le peintre et dessinateur Marten de Vos (1532-1603). En effet, la figure composite de la vierge aux attributs est particulièrement développée par l’artiste. On l’observe notamment dans la partie droite d’une huile sur toile conservée au musée Jeanne d’Aboville, à l’avant-plan (fig. 5). Finalement, elle devient centrale dans une estampe conservée par la Bibliothèque nationale de France, gravée par Théodore Galle d’après Marten de Vos (fig. 6).




Figure 5 — Marten de Vos, Les vierges sages et les vierges folles, [1570], huile sur bois, 125 x 191.5 cm, La Fère, musée Jeanne d’Aboville, © GrandPalaisRmn / Benoît Touchard.
Figure 6 — Théodore Galle, d’après Marten de Vos, Parabole des vierges sages et des vierges folles, gravure sur cuivre, état II, 36.7 cm x 44.0 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des estampes. © photographie personnelle.
Notes de bas de pages
[1] « Quant aux vivants tenus en estime dans ce pays, il faut citer d’abord, pour ses nombreux tableaux et ses gravures sur cuivre, Frans Floris, élève de Lambert Lombard déjà mentionné. Il passe pour tout à fait supérieur et a si bien travaillé dans tous les domaines de la peinture qu’on s’accorde à le trouver sans rival dans l’expression des émotions, douleur, joie et autres manifestations affectives, avec des trouvailles d’une grande et singulière beauté. Si bien qu’on l’appelle par analogie le Raphaël flamand. » dans Giorgio vasari et André chastel, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, vol. 12 : 10, Paris : Berger-Levrault, (Arts), 1986.
[2] Citons, à titre d’exemple, l’évangéliaire de Rossano, datant du VIe siècle, conservé au musée diocésain de Rossano en Calabre. Composé des textes des évangiles selon saint Matthieu et saint Marc, il présente une version enluminée de la parabole des dix vierges, régie par une composition bipartite séparée par une porte fermée : à droite, les cinq vierges sages vêtues de blanc sont aux côtés du Christ tandis qu’à gauche, les cinq vierges folles voient l’entrée leur être refusée.
[3] Il est primordial de convoquer ici la notion d’ « exégèse visuelle » telle qu’elle est théorisée par Paolo Berdini dans son ouvrage manifeste The Religious Art of Jacopo Bassano: Painting as Visual Exegesis, Cambridge : Cambridge university press, (Cambridge studies in new art history and criticism), 1997 : « La parabole [ici, du bon samaritain] ne peut être visualisée sans que le peintre ne complète son récit, montrant plus que ce que le texte raconte. », p. 2.
[4] La notion de condensation est évoquée pour la première fois par Sigmund Freud dans L’interprétation du rêve (1900). Telle que développée dans la théorie psychanalytique, la condensation serait un mécanisme développé par l’inconscient qui réunirait en une seule et même image ou représentation fictive (rêve, lapsus, symptôme), plusieurs pensées ou désirs qui, imagés de manière distincte se trouveraient censurés par l’individu. Daniel Arasse transpose cette notion au sein de la théorie de l’art pour la première fois dans son ouvrage Le sujet dans le tableau. Essai d’iconographie analytique (1997) dans lequel il établit un lien entre l’effet de condensation iconographique et les sources multiples de l’œuvre : « Le plus souvent, loin d’avoir une source unique, tableaux, fresques, dessins, sculptures superposent, entremêlent et condensent des textes différents (et parfois hétérogènes) » (cf. Arasse, 2010 : p.15-16). Dans son essai On n’y voit rien. Descriptions (2000), l’historien de l’art convoque à nouveau ce concept et l’illustre au travers de la démonstration du caractère composite de la figure de Marie Madeleine au sein d’un chapitre dédié intitulé « La toison de Madeleine » (cf. Arasse, 2005 : p. 79-93).
[5]Edward H. WOUK, Frans Floris (1519/20-1570): imagining a Northern Renaissance, Leiden Boston, Brill, (Brill’s studies in intellectual history), dir. Walter Melion, vol. 267, 2018, p. 339.
[6]L’hypothèse avancée ici, selon laquelle la lecture et l’étude de l’Anticlaudianus pourraient avoir tenu une place dans les recherches visuelles de Frans Floris, s’appuie sur la présence de deux manuscrits de L’Anticlaudianus dans les collections de l’imprimeur érudit et du savant collectionneur anversois, Christophe Plantin. Cf. Henri STEIN, Manuscrits du musée Plantin Moretus : catalogues de 1592 et de 1650 / par Henri Stein, archiviste-paléographe, 1886, [En ligne], , (consulté le 20 septembre 2024), p. 8.
[7] Martianus Mineus Felix CAPELLA et Jean-Frédéric CHEVALIER, Les noces de Philologie et de Mercure. Tome I. Livre I, Paris, les Belles lettres, (Collection des universités de France, 407), 2014, p. 16, §23.
[8] Dans l’Anticlaudianus, Prudentia est, à plusieurs reprises, surnommée Sophya (la « Sagesse »), établissant ainsi un lien entre ces deux concepts. Si dans son édition commentée du texte, Florent Rouillé précise que le personnage de Prudentia ne doit pas être confondu avec la vertu cardinale chrétienne (cf. Alain DE LILLE, Florent ROUILLE (éd. scien.), Anticlaudianus, trad. fr., Genève : Librairie Droz, 2022, Livre I, note de bas de page 157, p. 311), nous mettons en avant ici l’hypothèse d’une superposition sémantique entre, d’une part, la Prudence/Sagesse païenne et intellectuelle de l’Anticlaudianus et, d’autre part, la sagesse des vierges de la parabole matthéenne, qui est précisément caractérisée par la vertu de prudence dont font preuve les vierges qui prévoient de l’huile supplémentaire. Dans son édition de l’Anticlaudianus, le professeur Robert Bossua (École nationale des Chartes) résume ainsi le rôle de Prudence : « Quand les Vertus, unissant leurs efforts, auront créé l’homme nouveau, Dieu leur viendra en aide et suppléera par sa grâce aux imperfections de l’œuvre naturelle. Prudence paraît qualifiée pour être, auprès du Créateur, l’ambassadrice des vertus. », dans Alain DE LILLE, Robert BOSSUAT (éd.) Anticlaudianus. Texte critique avec une introduction et des tables, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, (Textes philosophiques du Moyen Age, I), 1955, (ca. 1182-1183), p. 27.
[9] Ilsetraut HADOT, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique: contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, 2nde éd. revue et considérablement augmentée, Paris, J. Vrin, (Textes et traditions, 11), 2005, p. 139.
[10] « artisque cunctas solita, quaeque caelitum possunt parare mente adacta culmina » cité dans ibid., p.146.
[11]Alain DE LILLE, Robert BOSSUA (éd.), Ibid.
Bibliographie
Sources :
CAPELLA Martianus Mineus Felix et CHEVALIER Jean-Frédéric, Les noces de Philologie et de Mercure. Tome I. Livre I, Paris, les Belles lettres, (Collection des universités de France, 407), 2014.
DE LILLE Alain, Anticlaudianus. Texte critique avec une introduction et des tables, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, (Textes philosophiques du Moyen Age, I), 1955.
VASARI Giorgio et CHASTEL André, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, vol. 12 : 10, Paris, Berger-Levrault, ‘Arts), 1986.
Études :
ARASSE Daniel, Le sujet dans le tableau: essais d’iconographie analytique, Paris, Flammarion (Nouvelle éd.), 2010.
ARASSE Daniel, On n’y voit rien: descriptions, Paris, Denoël, (Médiations), 2005.
BAKHOUCHE Béatrice, « L’allégorie des Arts libéraux dans les “Noces de Philologie et Mercure” de Martianus Capella (II) », dans Latomus, vol. 62, Societe d’Etudes Latines de Bruxelles, no 2, 2003, p. 387-396, [En ligne] <https://www.jstor.org/stable/41542490>, (consulté le 3 mai 2024).
BERDINI Paolo, The Religious Art of Jacopo Bassano: Painting as Visual Exegesis, Cambridge : Cambridge University Press, (Cambridge studies in new art history and criticism), 1997.
GUIDERDONI Agnès, « La figure réinventée au début de la période moderne », dans Réforme, Humanisme, Renaissance, vol. 77, no 1, 2013, p. 17-30, [En ligne] <https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2013_num_77_1_3326>, (consulté le 27 avril 2024).
HADOT Ilsetraut, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique: contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, 2nde éd. revue et considérablement augmentée, Paris, J. Vrin, (Textes et traditions, 11), 2005.
LAMY Alice, RAFFARIN Anne et SÉRIS Émilie, Dignité des « artes »: promotion et évolution des arts libéraux de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Honoré Champion éditeur, (Colloques, congrès et conférences sur le Moyen âge, 30), 2022.
MARIN Louis, « Le concept de figurabilité, ou la rencontre entre l’histoire de l’art et la psychanalyse. », dans De la représentation, Paris, Gallimard le Seuil, (Hautes études), 1994, p. 62-70.
RÉAU Louis, « La vie intellectuelle ou les Arts Libéraux » dans Iconographie de l’ art chrétien, T.1. Introduction générale, Paris, Presses universitaires de France, 1957, p. 154-162.
WOUK Edward H., Frans Floris (1519/20-1570): imagining a Northern Renaissance, Leiden Boston, Brill, (Brill’s studies in intellectual history), dir. Walter Melion, vol. 267, 2018.
© 2025. All rights reserved.